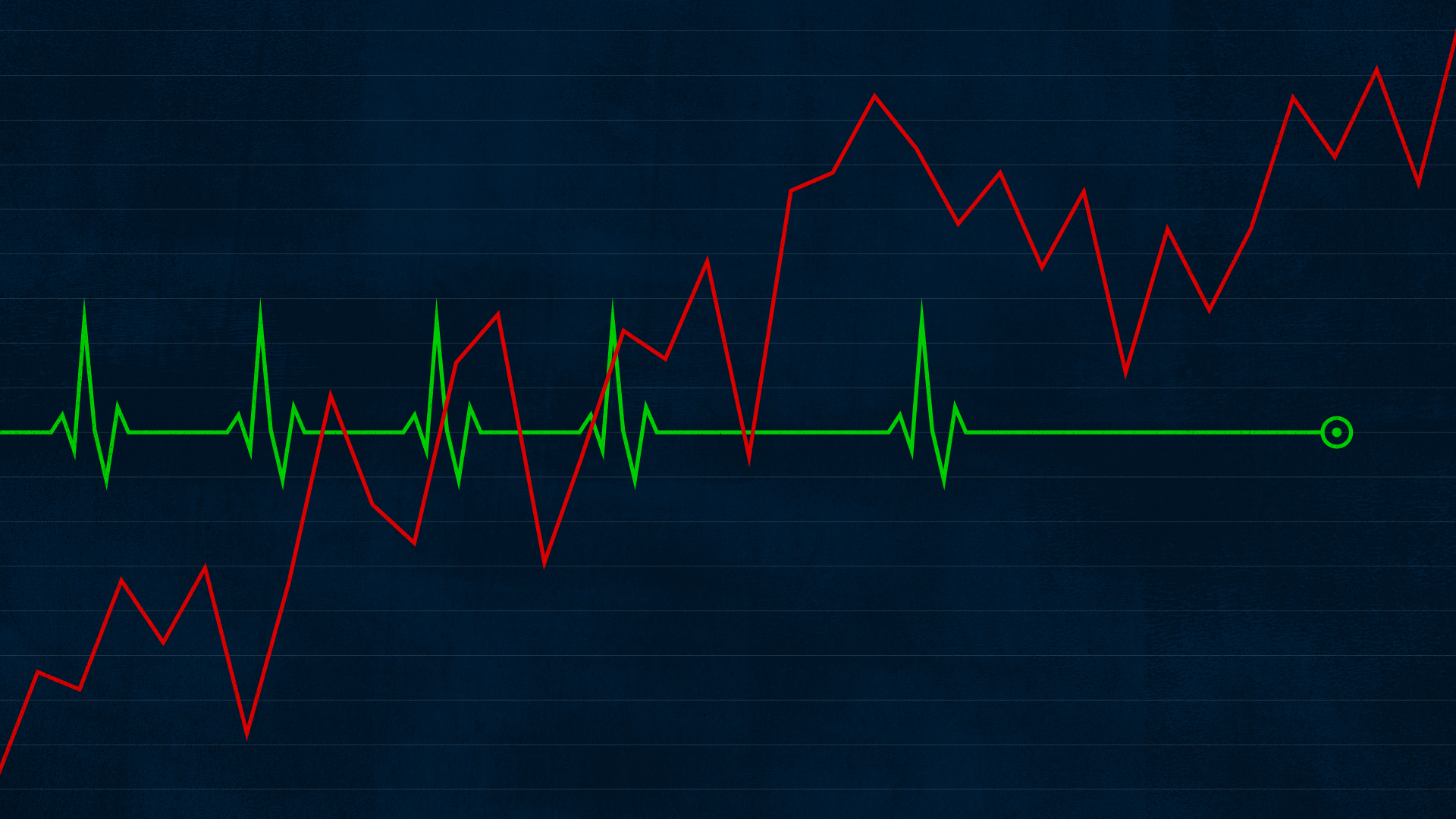Le capitalisme et le soin de l’autre sont-ils incompatibles ?
Voici ce que Milton Friedman écrivait en 1962 : « le business n'a qu'une responsabilité sociale, et une seule : utiliser ses ressources et s'engager dans des activités destinées à accroître ses profits, et cela aussi longtemps qu'il [le fait] sans tromperie ni fraude. »
Smithfield Foods est une société américaine implantée aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Forte de ses 3700 employés, son usine de transformation de viande de porc de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, est la neuvième plus grande usine aux États-Unis. Lorsqu’elle est pleinement opérationnelle, elle transforme près de 20 000 porcs par jour en aliments divers.
Au début de la pandémie de COVID-19, alors que de nombreuses entreprises se voyaient contraintes de fermer temporairement leurs portes pour endiguer la propagation du virus, Smithfield est restée ouverte ; en tant que fournisseur de produits alimentaires, elle faisait partie des services essentiels. Mais pour l’usine de Sioux Falls, ceci s’est avéré problématique.
Le 26 mars 2020, alors que le nombre de cas était en plein essor sur la côte Est, le journal local Argus Leader signalait un cas confirmé de COVID-19 à Smithfield. La direction décida pourtant de continuer de faire fonctionner l’usine et proposa une prime aux employés. Le 9 avril, on pouvait lire dans le quotidien que « certains des ouvriers disent ne pas se sentir en sécurité et ne pas considérer la ‘prime responsabilité’ de 500 USD [...] comme suffisante pour compenser le risque encouru pour leur santé, voire leur vie. » De nombreux employés, notamment ceux qui travaillent côte à côte sur la chaîne de production, viennent de classes socioéconomiques défavorisées. Leur situation financière est précaire. On peut comprendre leur sentiment d’avoir été placés face à un choix cruel entre leur santé et leur emploi.
Le 2 avril, 19 cas étaient confirmés au sein de l’usine, ce qui poussa Smithfield à mettre en place un protocole de test plus robuste. Pourtant au 11 avril, le cas unique détecté à Smithfield s’était démultiplié pour atteindre les 369 cas, selon un rapport du CDC. L’usine n’avait toujours pas cessé de fonctionner, même si à partir du 12 avril, la production était réduite, puis totalement interrompue, le temps que le Département de la Santé du Dakota du Sud et le CDC mènent une enquête. Entre le 16 mars et le 25 avril, les laboratoires confirmaient 929 cas de COVID-19 parmi les employés (soit 25,6 % des effectifs de l’usine) et 210 cas supplémentaires parmi les personnes de leur entourage en contact direct avec eux.
L’hésitation de Smithfield à agir immédiatement et avec force trouvait des échos un peu partout dans le monde, d’abord à cause d’une certaine inertie accompagnée d’un manque général d’accès à des informations claires, à quoi il fallait ajouter la gravité des enjeux économiques. Retirer de la chaîne de production alimentaire un rouage d’une importance aussi majeure que l’est l’usine de Smithfield aurait eu un impact sur de nombreux acteurs, depuis les producteurs d’aliments pour porcins, aux acheteurs de viande de porc destinée aux consommateurs. Certes, rester ouvert tout en garantissant la protection de tous était possible, mais pas sans engager d’importantes dépenses. Smithfield semble avoir donné la priorité aux profits. Son dilemme se situait à l’intersection de deux motivations concurrentes : gagner de l’argent et prendre soin d’autrui.
Ce dilemme concerne les entreprises de tous les domaines et de tous les pays. Les grandes questions sont faciles à poser, y répondre l’est moins : de qui ou de quoi les entreprises doivent-elles prendre soin en priorité ? De leurs clients, de leurs employés ou de leurs actionnaires (à savoir, de leur marge) ? Ont-elles une responsabilité éthique ? Doivent-elles prendre en considération la santé des employés et de la société dans son ensemble dans le cadre de leurs prises de décision ? En cas de catastrophe telle que la pandémie de COVID-19, quelle doit être la priorité ?
Ce dilemme est au cœur du système capitaliste dont nous sommes tous partie prenante, où que nous soyons dans le monde. Et il n’existe pas de réponse facile.
La logique du marché libre
La responsabilité de l’entreprise était au cœur du travail de Business Roundtable (une association à but non lucratif rassemblant des PDG des plus grandes sociétés américaines) lors de la publication en août 2019 de la dernière version de son document sur les principes de gouvernance en entreprise (Principles of Corporate Governance). Dans un virage radical par rapport à sa prise de position de 1997, l’association considère désormais que la finalité d’une entreprise n’est plus de maximiser en premier les bénéfices au profit des actionnaires, mais plutôt de veiller en même temps aux bénéfices pour les autres « acteurs » : employés, clients et concitoyens.
Il s’agit d’une évolution surprenante, spectaculaire. L’idée que les entreprises se focalisent sur autre chose que la seule marge de profit réfute des décennies du dogme capitaliste du marché libre. Pondérons les choses ; il semble peu probable que cette déclaration publique fasse réellement évoluer le comportement de quiconque, mais le simple fait que ça ait été dit est déjà remarquable. Il serait bon de se demander quelles pourraient en être les conséquences dans un système de marché libre qui est aujourd’hui réellement mondial.
« Certes, cette déclaration constitue la réfutation bienvenue d’une conception fallacieuse et pourtant particulièrement influente de la responsabilité sociale, [...] mais la seule manière de forcer les entreprises à agir dans l’intérêt public, c’est de les soumettre à une réglementation juridique. »
La conception classique du marché libre considère qu’une entreprise doit se concentrer uniquement sur les gains monétaires au profit de ses actionnaires et à l’exclusion de tout le reste. Selon cette théorie, toute société doit investir la totalité de ses ressources dans la maximisation du profit. Procéder autrement, comme l’économiste américain Milton Friedman l’a écrit en 1962, pourrait « efficacement saper les bases mêmes de notre libre société. » Par conséquent, les emplois et les salaires sont réduits au minimum, les heures de travail sont augmentées et les employés sont engagés et renvoyés sur la base de ce qu’ils coûtent et de leur niveau de productivité. Cela signifie également que d’autres facteurs tels que les impacts environnementaux et éthiques, la transparence des déclarations des sociétés et la santé des employés (comme dans le cas de Smithfield) passent nécessairement en arrière-plan.
Les principes fondamentaux du capitalisme existent depuis longtemps, sous des formes différentes. De tout temps, les peuples ont souhaité acquérir, mais ce n’est que relativement récemment que le système du marché libre tel que nous le connaissons aujourd’hui est apparu. Au XVIIIe siècle, le philosophe politique écossais Adam Smith revendiquait dans sa célèbre et révolutionnaire description de ce système que l’intérêt personnel bénéficie à tous. « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, disait-il dans La richesse des nations, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. » Le boulanger cherche à gagner de l’argent, et pour cela produit du pain (que nous recherchons) pour le vendre ; à notre tour, nous procédons de notre propre intérêt personnel dans la production de biens et de services que nous vendons.
Le capitalisme libéral est fondé sur ce principe. C’est un système où l’on prend pour soi. Si nous n’avions pas de bénéfice à en tirer, nous ne subviendrions pas aux besoins des autres.

La liberté de mouvement
Il y a une autre caractéristique du capitalisme qui mérite également notre attention : pour qu’il y ait marché libre, il faut du mouvement. Ce mouvement doit être constant. Il faut acheter et vendre, générer et accumuler, pour ensuite redéployer de la richesse, et il faut le faire sans interruption. Le boucher, le brasseur et le boulanger doivent produire et vendre au quotidien pour survivre. La stagnation, c’est l’anéantissement. Les biens, les services et la main d’œuvre doivent être en perpétuel mouvement, comme le disait Henry James dans sa description mémorable de la ville de New York au début du XXe siècle, pour que tous bénéficient. L’importance du mouvement est rendue d’autant plus évidente lors des pauses forcées, que sont par exemple une récession ou une pandémie. Dans un tel contexte, la réaction initiale du marché est souvent la panique.
Friedman se situe dans une autre perspective ; à l’obsession du mouvement, il préfère la liberté de mouvement. Selon lui, le capitalisme correspond parfaitement au concept de liberté, qu’il apparente au libéralisme tel qu’il existait avant le XXe siècle. Selon cette perspective libérale des débuts, écrit-il, l’objectif idéal du marché est de « préserver, pour chaque individu pris séparément, un degré maximal de liberté qui soit compatible avec la nécessité de ne pas empiéter sur la liberté d'autrui. »
Pour Friedman, l’importance de la liberté signifiait que toute restriction quelle qu’elle soit imposée par des gouvernements, sociétés ou autres autorités, était absolument intolérable, en-dehors du strict minimum. Il honnissait en particulier toute contrainte imposée aux mouvements des biens, des services et des travailleurs.
« Ce que les défenseurs du marché libre, les économistes néo-libéraux comme on les appelle souvent, nous disaient, était au mieux partiellement vrai et au pire totalement faux [...] Les ‘vérités’ colportées par ces idéologues du marché libre se fondent sur des partis-pris faciles et des points de vue mal éclairés. »
L’attrait de la liberté et du mouvement sans contrainte est indéniable. Cette forme de capitalisme a été la philosophie fondamentale de nombreuses figures majeures des récentes décennies. L’ancien Président des États-Unis Ronald Reagan en faisait l’éloge : « Lorsqu’on la laisse libre, l’économie de marché a quelque chose de magique. » Pour certains, il n’y a pas d’autre manière de vivre. L’auteur et journaliste Thomas Friedman écrivait en 1999 que « le marché libre est la seule gauche idéologique alternative, » alors que Milton Friedman, pour qui l’absence de contrainte, plus qu’un simple protocole économique, était une philosophie de la vie, déclarait : « La liberté est une plante rare et délicate. » En 1990, au moment où l’hubris libertarien occidental avait sans doute atteint son apogée, le groupe de rock Primal Scream chantait : « We wanna be free to do what we wanna do. » (Ce qu’on veut c’est être libre de faire ce qu’on veut).
Tout ceci peut sembler merveilleux et l’attrait naturel du capitalisme a connu un immense succès. Et pourtant, force est de constater qu’émerge aujourd’hui une sorte de bourbier de conséquences malvenues auxquelles nous ferions bien de prêter attention.
Ironie et dilemme
Les décennies de capitalisme de libre marché ont produit énormément de richesse (certes inégalement répartie), avec pourtant des résultats plutôt maigres en termes de relations humaines. Dans ses pires extrêmes, le capitalisme est un maître féroce, cynique même. Il n’encourage pas l’altruisme. Il s’intéresse à la fonctionnalité des personnes, utilisées et déplacées selon ce que décide le marché.
Ayn Rand, auteure et théoricienne russo-américaine, est parmi les plus catégoriques lorsqu’elle écrit : « aucun créateur [penseur, artiste, scientifique, inventeur] n’est mu par le désir de servir ses frères [...] Le créateur ne sert rien ni personne. Il vit pour lui-même. »
L’économiste Ha-Joon Chang expose narquoisement toute l’ironie contenue dans cette idée : « Le marché excelle dans l’art de mettre à profit l’énergie de personnes égoïstes qui ne pensent qu’à elles (ou au plus, à leurs familles) pour promouvoir l’harmonie sociale. » S’il rejette le caractère insensible qui sous-tend cette perspective, il ne serait pourtant pas faux de l’appliquer aux ateliers clandestins d’Asie du Sud, aux services de livraison multinationaux ou à toute société qui propose à ses employés des contrats « zéro-heure ». Ce n’est pas que le capitalisme occulte des qualités telles que l’honnêteté et l’intégrité, mais il les considère essentiellement comme des fonctions égoïstes dont l’utilité première est de maximiser les profits.
« Le business n’a qu’une responsabilité sociale et une seule : utiliser ses ressources et s’engager dans des activités destinées à accroître ses profits, et cela aussi longtemps qu’il [le fait] sans tromperie ni fraude. »
Sur une note plus positive, la théorie soutient également que le marché permet de tempérer les excès de l’humanité. Par exemple, les sociétés ne peuvent pas fixer les prix trop haut, puisqu’un concurrent pourra vendre moins cher ; les travailleurs ne peuvent pas se laisser aller, car ils savent qu’ils peuvent être facilement remplacés. Ceci parait logique, même si on peut également se demander si un monde dans lequel prime l’intérêt personnel brut est une issue particulièrement souhaitable.
Au début du XXe siècle, le sociologue et théoricien politique allemand Max Weber a réfléchi au clair potentiel que « l’esprit du capitalisme » soit réduit à l’utilitarisme selon lequel « l'honnêteté est utile puisqu'elle nous assure le crédit. De même, la ponctualité, l'application au travail, la frugalité ; c'est pourquoi ce sont là des vertus. On pourrait en déduire logiquement que, par exemple, l'apparence de l'honnêteté peut rendre le même service ; que cette apparence suffirait et qu'un surplus inutile de cette vertu apparaîtrait [...] comme étant une prodigalité improductive. » Selon ce point de vue, les vertus morales se résument à de la matière brute, en vue du profit.
Cette perspective insensible, Weber l’admet, est souvent cause de souffrance. On peut facilement comprendre que la perte d’un employé pour cause de maladie, comme dans l’exemple du premier patient de COVID-19 de Smithfield, ou d’un athlète professionnel qui souffre de traumatisme crânien, peut être vue uniquement comme le rouage qui ne produit plus et doit être remplacé.
Dans le cas de Smithfield, le dilemme était tout aussi épineux qu’il était réel. Si l’employé malade reste chez lui, la rentabilité de l’entreprise risque de baisser. La perspective d’une fermeture complète de l’entreprise amplifie à l’extrême la perte financière. Sans compter que Smithfield étant l’un des plus gros employeurs de la région, l’entreprise est un facteur de santé sociale et économique dans toute la région. Enfin, fermer une usine peut menacer la viabilité d’autres acteurs en aval et en amont dans la chaîne d’approvisionnement.
Une entreprise doit-elle se concentrer uniquement sur le profit ? Dans quelle mesure doit-elle considérer l’impact qu’ont ses décisions sur tant d’autres, notamment sur ses employés ? Les employés sont à la fois des êtres humains et, au sens économique, les mécanismes qui génèrent des profits (ici sous la forme de côtes de porc, de jambons tranchés et autres produits similaires). Leurs compétences en tant qu’humains à travailler, produire, innover sont à prendre en compte, comme le sont aussi leur sécurité, leur santé mentale et leur estime d’eux-mêmes, etc.
Ce sont ces dernières considérations, qui ne sont pas liées de manière immédiate ou évidente aux profits, que les entreprises commencent tardivement à prendre en compte.
L’obsession du travail
Dans la pratique, il existe assurément de nombreuses approches plus indulgentes et moins cyniques partout dans le monde. Le capitalisme pratiqué en Chine est différent de celui des États-Unis, qui diffère à son tour de celui de la Suède. Mais in fine, les priorités du système refont rapidement surface. Lorsqu’on est formé dans l’idée de l’intérêt personnel, lorsqu’on est « contraint » (pour utiliser un terme employé par Weber) de vivre de cette manière, l’instinct de survie ainsi déclenché centre sur soi ; on veut préserver son emploi, se nourrir et se sentir en sécurité. Dans le système capitaliste, cela veut dire partir en quête du Numéro Un ; et du point de vue de l’entreprise, le « Numéro Un », traditionnellement, c’est le profit. Par conséquent, certaines préoccupations telles que le soin des employés, le don caritatif, la bonne gestion de l’environnement, l’éducation publique et même la survie des petits concurrents sont mises sur la touche car elles sont considérées comme de prime abord moins importantes.
On peut donc se demander si le monde est voué à un système dont les fondements sont antinomiques avec la sollicitude mutuelle.
L’indifférence du capitalisme pour la santé ne se limite pas à l’aspect physique ; sa focalisation sur le profit a également de graves conséquences pour le bien-être mental. Nos vies professionnelles sont indéniablement caractérisées par le stress et une anxiété extrême. Nous sommes nombreux de nos jours à nous dire très occupés, alors même qu’au quotidien, nous utilisons différents moyens pour gagner du temps : téléphones portables, machines à laver et imprimantes numériques. C’est un paradoxe, mais il est fort possible qu’au cœur même du système capitaliste, il y ait une obsession du mouvement.
Le philosophe allemand Walter Benjamin compare le capitalisme à une religion. Selon lui : « Il n’y a pas de “jours ordinaires”, pas de jour qui ne soit jour de fête, dans le sens terrible du déploiement de la pompe sacrée, de l’extrême tension qui habite l’adorateur. » Il n’y a pas de repos, pas de répit. Le temps, c’est de l’argent. Chaque instant pourrait et même devrait être consacré à la poursuite de l’acquisition et du profit. Il écrit plus loin que « le capitalisme est probablement le premier exemple d’un culte qui n’est pas expiatoire mais culpabilisant [...] Un état qui offre si peu d’issue est culpabilisant. » Un tel sentiment de culpabilité fait écho à l'anxiété qui semble si présente de nos jours.
Weber lui aussi s’étonnait de l’avidité implacable caractéristique du capitalisme, interloqué qu’il nous pousse ainsi à s’évertuer à acquérir plus que ce dont on a légitimement besoin.
« [...] Cette éthique, [...] gagner de l'argent, toujours plus d'argent, [...] est à ce point considérée comme une fin en soi [que l’argent] apparaît entièrement transcendant et absolument irrationnel sous le rapport du “bonheur” de l'individu ou de l'“avantage” que celui-ci peut éprouver à en posséder [...] »
Cette obsession peut s’observer partout dans la société capitaliste, depuis l’habitude de travailler de longues heures à l’investissement acharné des hyper riches. Ceci ne signifie pas nécessairement que le capitalisme ait créé notre désir de plus, mais plutôt qu’il l’encourage, avec des conséquences malvenues sur notre style de vie. Se pourrait-il que le capitalisme soit contraire au bonheur et à la joie ?
Par exemple, en dépit des promesses du contraire, le salaire des ouvriers aux États-Unis n’est pas plus élevé aujourd’hui (lorsqu’on prend en compte l’inflation) qu’en 1970. Certains soutiennent que les avantages sociaux des employés, tels que l’assurance-santé que fournissent les employeurs, ont augmenté et que le salaire réel est par conséquent supérieur. Pourtant, le fait que de nombreux employeurs s’acquittent de la part du lion des primes d’assurance pour les familles, qui coûtent aujourd’hui en moyenne plus de 21,000 USD par an par employé, n’augmente pas le pouvoir d’achat de l’ouvrier au quotidien. Par conséquent, de nombreux ménages ne peuvent se limiter à un seul salaire.
Conformément au capitalisme, c’est une bonne chose : si dans chaque ménage, il y a deux emplois et que par conséquent ceci entraîne d’autres emplois (par exemple pour le soin des enfants ou pour les tâches domestiques), le taux de chômage baisse et la productivité et le marché sont en hausse. Pourtant, la réalité n’est pas aussi limpide et les conséquences telles que la baisse du temps disponible pour les divertissements, l’éducation des enfants et le soin de la relation des époux et autres relations n’ont sans doute pas encore été appréciées à leur juste valeur.
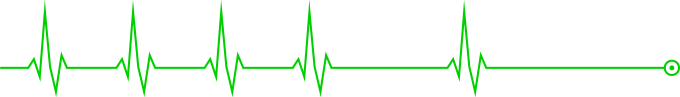
Inégalité des opportunités
Le marché libre influe également sur la confiance et l’estime de soi, que le système met en lien direct avec le salaire et la productivité. Les salaires phénoménaux des plus grands PDG, selon la théorie du marché libre, sont justifiés en ce qu’ils reflètent toute la valeur que ces derniers génèrent au profit de l’entreprise. Voici comment Chang le décrit : « Si les PDG sont payés 300 fois plus que l’ouvrier moyen, dit-on, cela doit être parce qu’ils apportent à l’entreprise 300 fois plus en termes de valeur ajoutée. » Effectivement, c’est plus ou moins ainsi que Milton Friedman concevait les choses. Concernant les disparités des conditions de vie suivant les régions du monde, selon lui : « si le travailleur japonais a un plus bas niveau de vie que le travailleur américain, c'est parce qu'il est moins productif en moyenne que l'Américain. »
Il faut ici attirer l’attention sur l’expression « en moyenne » ; le concept est douteux d’entrée de jeu, mais il n’est en outre viable que si l’énorme écart entre les riches et les pauvres est occulté. Sans compter sa singularité (comme le sarcasme d’un commentateur le montre dans sa question : « vous êtes-vous déjà dit que le travail fourni par Jeff Bezos [PDG d’Amazon] était 130 milliards de fois supérieur au votre ? »), ce concept est difficile à réconcilier avec l’estime de soi des employés, en particulier celle des personnes aux échelons socioéconomiques inférieurs, et il omet totalement d’autres facteurs tels que l’environnement.
« Je ne remets pas en cause le fait que certaines personnes sont plus productives que d’autres et qu’il faille les payer plus, parfois beaucoup plus [...] La question est de savoir si l’écart actuel se justifie. »
On dit souvent que l’homme d’affaires Warren Buffett aurait déclaré : « Plantez-moi en plein Bangladesh ou au milieu du Pérou ou autre, et on verra bien tout ce que mon talent produira sur ces terres inhospitalières [...] Je travaille dans un système de marché qui, se trouve-t-il, récompense bien trop et sans proportion aucune ce que je fais très bien. »
Les choses ont tourné à l’avantage de Buffett, mais que dire des employés qui travaillent de longues heures en échange d’un salaire minime, sans sécurité d’emploi et en l’absence de tout espoir réaliste de faire évoluer leur situation ? Quel est le regard qu’ils doivent avoir d’eux-mêmes ? L’idée de la mobilité sociale que les défenseurs du marché libre brandissent et selon laquelle, comme l’explique Chang, tous acceptent de telles conditions parce que « leurs propres enfants pourraient devenir le prochain Thomas Edison, J.P. Morgan ou Bill Gates » est un fantasme qui ne tient pas, même dans l’idylle du marché libre. L’inégalité est partie intégrante du système capitaliste. D’ailleurs, on peut probablement dire que l’inégalité est le meilleur produit du capitalisme.
La meilleure option ?
En définitive, la focalisation sur le seul profit et la confiance en la bienfaisance de l’intérêt propre nuisent à l’humanité à plusieurs titres. Et pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de défendre le système. Même Chang, pourtant critique de ses nombreux excès « pense que le capitalisme demeure le meilleur système économique inventé par l’humanité. »
En changer les priorités, comme le suggérait la Business Roundtable, ne serait pas facile, d’autant plus que le capitalisme semble être le prolongement logique des principes et idéaux que nos sociétés estiment le plus. Weber, par exemple, parle beaucoup des aspects « rationnels » du capitalisme moderne, tel qu’il s’est développé partout en Occident dans la suite (et en grande partie à la faveur) de la Réforme protestante et de l’éthique de travail auxquelles elle a donné naissance. Milton Friedman considère le marché comme la conclusion logique évidente pour tout être humain libre penseur : « l'unanimité sans uniformité ; c'est un système de représentation effectivement proportionnelle. » La rationalité et la démocratie ; n’est-ce pas ce que la société occidentale valorise le plus ?
Et pourtant, les résultats du marché libre s’avèrent très décevants. L’inégalité entre les riches et les pauvres, pour ne prendre que cet exemple, est vertigineuse. À la fin de 2019, selon le Global Wealth Report, le rapport sur la richesse mondiale de Crédit suisse de 2020, « les millionnaires de toute la planète, qui représentent exactement 1 % de la population adulte, détenaient 43,4 % de l’actif net mondial. Par contraste, la richesse de 54 % de tous les adultes ayant un actif inférieur à 10 000 USD atteignait de haute lutte à peine 2 % de la richesse mondiale. »
En dépit des promesses des politiciens, il n’y a pas eu de répartition des richesses et le rêve de la mobilité sociale semble de plus en plus inatteignable. Ceci a eu des effets dévastateurs sur les marchés émergents, en Russie par exemple, et dans toute l’Afrique. L’impact sur notre bien-être mental est incommensurable. Peut-être n’est-il donc pas surprenant que plutôt que de jouir des fruits d’un système supposé créer le maximum de bénéfices pour tous, nous vivions actuellement dans ce que certains qualifient d’ère anxieuse et indignée.
« Sur les 34 pays analysés, une médiane de 65 % des adultes dit être globalement pessimiste quant à la réduction de l’écart entre les riches et les pauvres dans leur pays. »
Que le capitalisme ait très mal estimé les besoins de l’humanité (en les ayant peut-être occultés, d’ailleurs) semble indubitable et la Business Roundtable, entre autres, commence à le comprendre. Et pourtant, sa déclaration de 2019 a rapidement suscité des doutes et même des critiques.
Les entreprises doivent-elles être socialement responsables ? Doivent-elles subvenir aux besoins de leurs employés ? Doivent-elles accéder aux besoins et demandes du public ? Doivent-elles, pour dire les choses clairement, prendre soin d’autrui ? On a de plus en plus tendance à répondre oui, par opposition à la théorie du marché libre qui existe depuis tant de décennies. L’ironie du sort, c’est que c’est le marché qui a suscité cette évolution : les médias traditionnels et les réseaux sociaux ont contraint les entreprises à changer de politiques. Par exemple, le problème du COVID de Smithfield n’aurait vraisemblablement pas été connu aussi rapidement sans la pression exercée par les médias.
Une démarche plus bienveillante pourrait bien être bénéfique, même s’il est peu probable qu’elle sera suffisante. Après tout, comme cela a déjà été dit, il existe un lien étroit entre le capitalisme et les valeurs les plus reconnues dans le monde d’aujourd’hui, de la démocratie au rationalisme. Parmi les activités du monde occidental, rares sont celles qui ne sont pas fondées sur les principes du capitalisme. Même dans le christianisme traditionnel, dans lequel on pourrait s’attendre à ce que l’intérêt propre soit découragé, certaines mouvances populaires promeuvent « l’évangile de la prospérité », selon lequel la richesse et la santé sont garanties à tous ceux qui ont suffisamment la foi, comme le prouvent, entre autres, les dons financiers octroyés à telle dénomination et à tel prédicateur.
Et justement, avec le temps, on a pu observer chez certains des fervents défenseurs du capitalisme une attitude comparable à de la foi. L’universitaire Eugene McCarraher dit sur le capitalisme qu’il s’agit de « la religion de la modernité » et de « l’évangile de la richesse et de sa promesse de rédemption par l’or ». Walter Benjamin avance pour sa part que « le capitalisme est une religion totalement sectaire », alors que la journaliste Naomi Klein parle d’une « religion du marché libre » et d’une « foi fondamentaliste ».
Il faut cependant noter qu’il ne s’agit pas d’une religion que la Bible pourrait défendre. Nonobstant la philanthropie, le capitalisme n’est pas connu pour faire l’apologie de ce que la Bible appelle le « deuxième plus grand commandement », l’impératif de mettre les besoins du prochain au même niveau que les nôtres. D’ailleurs, de nombreux principes fondamentaux du capitalisme sont contraires à ce que dit la Bible : le fait que la richesse soit l’équivalent de la réussite ; que se soucier de ses propres intérêts soit bénéfique pour tous ; que les profits doivent être maximisés autant que possible ; que la charité est une option parmi tant d’autres, loin d’être obligatoire ; ou que les acquisitions matérielles doivent être le principal objectif de notre vie. De fait, ces mêmes pages contiennent un avertissement relatif à la destruction ultime d’un système de vente et d’achat qui semble caractéristique du capitalisme tel que nous le connaissons de nos jours.
Les conséquences préoccupantes du marché libre devraient sans aucun doute nous faire réfléchir. De toute évidence, il ne s’agit pas d’un système qui œuvre en vue du bien de tous. L’entreprise de Smithfield était aux prises avec une situation inextricable, déchirée entre les principes du marché libre, sur lesquels se fonde sa réussite, et les intérêts des employés. C’est une impasse dans laquelle des milliers d’autres se sont trouvés, partout dans le monde, pendant la pandémie.
La question à se poser est donc la suivante : faut-il chercher mieux ?
Oui, selon McCarraher. Il songe à ce qui se produirait si la société se retournait contre le système : « Et si les perdants du marché refusaient d’accepter ses décrets [...] ? Et s’ils blasphémaient et rejetaient les édits du Marché et ses revendications imprévisibles et irresponsables ? » L’écrivaine, journaliste et critique Rebecca West exprime des doutes similaires sur le système dans Agneau noir et faucon gris (1941) : « Il semble évident que [le capitalisme] ne peut pas être plus que ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, et on ne peut pas le voir autrement que comme décevant. »
Comme McCarraher le fait remarquer, le capitalisme comme religion séculière a « transformé le monde en une entreprise commerciale » et nous a convaincu qu’il n’y avait pas de meilleure option. À cette fin, il est engagé dans une « guerre éclair contre la spéculation utopique, avec pour mission de saper la capacité même à rêver un monde qui transcende le capitalisme. » Pourtant, les critiques du système rêvent quand même. Klein garde espoir en un « nouveau paradigme de la civilisation ». McCarraher envisage une ère où « le travail ne se résumerait pas à un labeur visant à récupérer beaucoup d’argent en vue d’un accroissement vorace de la ‘productivité’ mais serait plutôt voué au soin et à l’épanouissement des personnes. »
Il ne fait aucun doute qu’un jour verra la fin du capitalisme ; aucun système conçu par l’homme ne peut perdurer à jamais. D’ailleurs, la vision que les critiques du système actuel nous donnent ressemble fort à ce « deuxième commandement » en action : un monde dans lequel les besoins de tous sont au premier plan dans nos pensées et où par conséquent, réaliser des bénéfices n’est plus le moteur principal. Ce jour ne saurait arriver trop vite.